Politique
Maghreb-États-Unis : La stratégie de fragmentation de Trump face aux lignes rouges régionales

Le 2 août 2025, Donald Trump a annoncé qu’il « réaffirmait le soutien constant des États-Unis à la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental ». En déclarant que l’initiative marocaine d’autonomie de 2007 constitue « la seule base sérieuse et réaliste » pour un règlement permanent, il a fermé la porte à l’ONU sur ce dossier. Par cette simple déclaration, Trump tente peut-être de provoquer un séisme géopolitique dans la région du Maghreb.
Par: Nizar Jlidi
Cette annonce n’était pas surprenante en soi, puisqu’elle s’inscrit dans le prolongement du premier mandat de Trump lorsque les États-Unis, en 2020, ont reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara en échange d’une normalisation des relations avec Tel-Aviv dans le cadre des « Accords d’Abraham ». Cependant, sa réaffirmation en 2025 en change la nature. Ce n’est plus une simple manœuvre diplomatique isolée, mais une étape politique structurelle dans un nouveau système américain pour la région. Trump n’entend pas suivre l’approche prudente de Biden ou la neutralité d’Obama. L’ère de l’ambiguïté est révolue – la question qui se pose est : pourquoi maintenant ?
Pour l’Algérie, qui soutient le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination, cette démarche est une provocation directe. La déclaration de Trump consacre un déséquilibre des forces entre Rabat et Tindouf. En sapant la possibilité d’un référendum populaire et en marginalisant les revendications du Front Polisario, Washington cherche à isoler le principal soutien diplomatique de l’Algérie sur ce dossier. Pire encore, la position de Trump s’aligne sur des positions similaires exprimées en 2025 par Londres et Paris, ce qui la rapproche d’un « consensus occidental » – ce qui pourrait sembler être une victoire apparente pour Rabat, mais n’est pas sans risque politique pour Trump sur de nombreux autres fronts où il n’est pas d’accord avec l’Europe.
Qui pourrait croire que Trump négocie de bonne foi ?
Ce virage vers le Maroc peut aussi être compris comme une forme de punition indirecte. L’Algérie n’a jamais accepté les implications politiques des Accords d’Abraham. Elle n’a jamais transigé sur ses relations avec Israël et a rejeté toute ingérence américaine dans la question du Sahara. Résultat ? Trump la pousse vers la marginalité. L’Algérie devient le pays qu’il faut encercler, épuiser, voire soumettre économiquement – comme en témoigne l’augmentation soudaine des droits de douane annoncée par Washington le 9 juillet (30% sur un certain nombre de produits industriels). C’était le prélude à un changement plus profond dans la relation.
Pour la Tunisie, la situation est plus ambiguë, mais tout aussi dangereuse. La Tunisie, qui a choisi la neutralité officielle sur le dossier du Sahara, a toujours maintenu un silence diplomatique prudent. Mais ce silence est devenu un fardeau dans un contexte de polarisation croissante. Le soutien explicite de Trump au Maroc place la Tunisie face à un dilemme stratégique : soit elle suit discrètement cette orientation, au risque de perdre sa réputation historique de pays neutre et solidaire au Maghreb, soit elle maintient ses distances et subit les conséquences d’un refroidissement probable avec Washington. En pratique, c’est un choix sans issue, tant les relations entre la Tunisie et l’Algérie sont solides.
Ce que Trump met en œuvre ne se limite pas au soutien au Maroc. Il s’agit d’un projet stratégique plus vaste qui redessine la carte des allégeances en Afrique du Nord. Chaque pays doit définir sa position – et ceux qui refusent de s’aligner sont exclus et punis. Ainsi, l’axe Rabat-Washington devient la mesure de la conformité régionale. Ceux qui acceptent le marché en retirent des bénéfices diplomatiques et économiques. Ceux qui refusent, comme l’Algérie et la Tunisie, subissent des pressions directes ou invisibles.
Il y a un autre aspect rarement évoqué : l’exploitation électorale du dossier. Trump ne s’adresse pas seulement aux peuples du Maghreb. Il s’adresse à ses électeurs. Sa base électorale – chrétienne évangélique, pro-israélienne et adepte de la force militaire – attend des positions fermes, claires et simplistes. En soutenant publiquement Israël, en marginalisant les soutiens traditionnels à la Palestine et en favorisant un allié comme le Maroc, Trump envoie des messages rassurants à l’intérieur sans faire de concessions diplomatiques réelles. Il semble aussi que sa stratégie africaine ne passera finalement pas par le Maghreb : la signature du « Cadre économique régional » le même jour, entre Kinshasa et Kigali à Washington – sous la supervision de Massad Boulos – constituera l’axe réel de ses politiques sur le continent.
Pressions, divisions et menaces : la stratégie de Trump face à la fermeté des positions maghrébines
Depuis des semaines, les émissaires de la nouvelle administration Trump parcourent l’Afrique du Nord à un rythme effréné. L’homme d’affaires libano-américain Massad Boulos, conseiller principal à la Maison Blanche pour le Moyen-Orient, a effectué une tournée dans plusieurs capitales maghrébines avec des résultats mitigés.
En Tunisie, sa visite a été tout sauf amicale. Les autorités tunisiennes, attachées à leurs traditions de neutralité diplomatique, l’ont accueilli avec une froideur manifeste. Outre l’accueil humiliant que lui a réservé le président Kaïs Saïed au palais de Carthage, des sources bien informées indiquent que les réunions à huis clos ont été marquées par une vive tension. Boulos a à peine voilé la volonté de Washington d’offrir des facilités financières en échange d’un rapprochement sécuritaire avec deux entreprises connues pour leur soutien public à Israël. Une offre inacceptable. Même politiquement explosive. Dans l’état d’esprit général des Tunisiens, la simple allusion à la normalisation équivaut à une trahison. Cela dépasse la politique. C’est un fait anthropologique, rejeté culturellement, religieusement et humainement, et surtout : un suicide politique.
En Algérie, les rencontres ont été moins tendues mais tout aussi vides de sens. L’Algérie a présenté une façade protocolaire sage : ni refus explicite ni acceptation claire. Une politique d’étouffement des initiatives sans confrontation avec elles. La présidence algérienne sait très bien que la simple évocation d’une normalisation avec Israël ouvre une brèche sociale et même institutionnelle. Aucune institution algérienne ne l’acceptera jamais. Et Trump – s’il est vraiment informé – le sait. Mais qui peut garantir quoi que ce soit avec lui ?
Alors pourquoi cette insistance si l’administration américaine sait d’avance que ni la Tunisie ni l’Algérie ne normaliseront ? Parce que l’objectif n’est pas de réussir la normalisation. Mais de tester la fermeté, de créer des divisions et de déstabiliser les équilibres. Trump ne cherche pas à construire un axe régional pro-américain. Il travaille à affaiblir les zones qu’il ne contrôle pas. Ce qui apparaît clairement dans la politique douanière américaine. Le 9 juillet, Washington a annoncé l’imposition de droits de douane punitifs : 30 % sur les exportations algériennes et 25 % sur les exportations tunisiennes. Aucun pays européen n’a été ciblé par de telles mesures. La justification officielle parle de « rétablissement de l’équilibre ». Mais en réalité, c’est un moyen de pression dirigé contre les deux capitales maghrébines qui refusent de s’aligner.
Ces mesures pourraient avoir des répercussions internes. En Tunisie, elles compliquent une situation économique déjà fragile, notamment dans les secteurs non énergétiques comme la mécanique, le textile et l’agroalimentaire. En Algérie, elles pourraient saper les ambitions économiques post-pétrolières. Dans les deux cas, les gouvernements sont contraints de rechercher des marges de négociation – sans la capacité ou la volonté de faire des concessions sur la Palestine, le Sahara ou la souveraineté nationale.
Selon la vision américaine, le Maghreb n’est plus une unité politique. Mais un archipel d’intérêts, remodelé selon la logique de Trump. Le Maroc est l’allié stable, en phase avec Israël et économiquement utile. L’Algérie est la puissance régionale qu’il faut encercler et peut-être étouffer. La Tunisie est le poids qu’il faut faire pencher à tout prix, quel que soit le dossier. Et en approfondissant les disparités, Washington contribue à mettre fin à ce qui reste du projet d’Union du Maghreb – et le paradoxe est que le Maroc lui-même a contribué, par sa normalisation suicidaire, à cet effondrement.
Il convient de noter que cette politique s’adresse d’abord au public américain. Trump ne façonne pas une diplomatie, mais un récit électoral qui peut se poursuivre même en cas de mandat futur du Parti démocrate. Aux yeux de son électorat, peu importe que la Tunisie ou l’Algérie refusent de se plier. Ce qui compte, c’est qu’il « les met sous pression », « protège Israël » et fait « payer les ingrats ». C’est une diplomatie de spectacle, où chaque crise devient une matière narrative. Et en se concentrant sur le Maroc, il assure la continuité de son discours : même si des personnalités démocrates comme Alexandria Ocasio-Cortez arrivent au pouvoir, porter atteinte aux intérêts israéliens restera interdit au pouvoir américain.
Stratégie de fragmentation et impasse
Ce que Trump applique en Europe, il le répète au Maghreb : la fragmentation stratégique. En renforçant certaines capitales et en marginalisant d’autres, il pousse les acteurs à s’isoler, à rompre avec la solidarité historique et à glisser vers des relations de dépendance bilatérale avec Washington. Il n’offre pas de projet régional stable. Mais il sème des lignes de fracture, comme il l’a fait auparavant en isolant le Maroc de ses voisins lors de son premier mandat. Il sait très bien que les Accords d’Abraham ne passeront pas en Algérie, en Tunisie ou en Libye. Le contexte populaire, politique et sécuritaire ne le permet pas et ne le permettra pas. C’est pourquoi il ne cherche pas à les intégrer, mais à les noyer. En les accablant de problèmes internes, en les montant les uns contre les autres, en les coupant de toute vision collective… C’est la politique de la « division active », une spécialité de Washington depuis des décennies.
Le Sahara occidental constitue ici l’outil idéal. C’est la blessure fondatrice du Maghreb, celle que même le rêve unitaire des années 1980 n’a pas réussi à panser. L’Algérie ne cédera pas, et le Maroc non plus. Et les institutions diplomatiques américaines le savent, même si Trump l’ignore. Lorsqu’il a renouvelé son soutien explicite à Rabat le 2 août, il n’a pas seulement renforcé la position du Maroc, mais il a aussi appuyé sur la blessure qui disloque l’unité de la région.
Derrière les positions publiques, il y a aussi une hypocrisie stratégique flagrante. Trump multiplie les déclarations « positives » envers l’Algérie : ouverture, partenariats énergétiques, respect de son rôle au Sahel… Mais ce sont des déclarations sans contenu. Car ses politiques contredisent son discours. Il ne cherche pas à intégrer l’Algérie dans une alliance, mais à la cantonner dans un rôle de « façade utile » sans valeur stratégique. Il ignore que l’hostilité commune envers l’Europe ne suffit pas à construire une alliance. Ni Boulos ni Trump – malgré leurs discours répétés sur la « souveraineté » – ne comprennent que la souveraineté algérienne n’est pas négociable.
Quant à la Tunisie, elle est considérée comme un État malléable. Trump pense pouvoir l’influencer, faire changer ses positions. Mais il se heurte à un mur invisible, mais infranchissable : la normalisation avec Israël. Ce n’est pas seulement une ligne rouge. C’est une ligne rouge, rouge, rouge. Un fait culturel, politique, existentiel. Le simple fait d’en parler ouvre la porte à une crise nationale. Ce n’est pas une possibilité, mais un scénario d’effondrement, quelle que soit l’identité de ceux qui gouvernent.
En fin de compte, Trump n’offre aucune vision pour l’avenir. Il impose un plan égoïste. Et son plan mène à une impasse.

-

 Culture1 mois ago
Culture1 mois agoDe la clandestinité à la division : Mohamed Kilani retrace l’histoire méconnue de la gauche tunisienne
-

 La Une3 semaines ago
La Une3 semaines agoTunisie : le juge Akermi paye son refus de soumettre la Justice à la police
-

 La Une1 mois ago
La Une1 mois agoTunisie : l’ancien président de la Cour de cassation condamné à 30 ans de prison
-
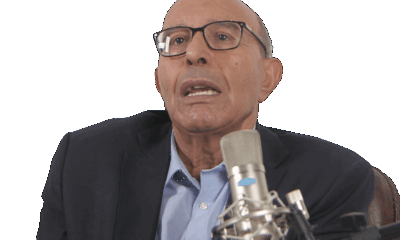
 La Une2 mois ago
La Une2 mois agoMohamed Kilani explique les circonstances de la formation de la gauche en Tunisie et les raisons de sa scission avec le PCOT .
-

 La Une2 semaines ago
La Une2 semaines agoMustapha Djemali libéré après 18 mois de détention
-

 BUSINESS2 mois ago
BUSINESS2 mois agoUne vingtaine d’enfants déférés à la justice après le mouvement de protestation à Gabès
-

 La Une2 semaines ago
La Une2 semaines agoKaïs Saïed exprime son vif mécontentement à l’ambassadeur de l’UE, Bruxelles réplique en défendant ses pratiques diplomatiques
-

 Culture2 semaines ago
Culture2 semaines agoDes dizaines de journalistes tunisiens en sit-in à la Kasbah pour défendre leurs droits







